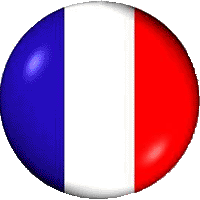Il n’est pas rare, pour le sportif, de devoir interrompre momentanément (ou pour plus longtemps) son entraînement, en raison de douleurs persistantes dans les muscles, les tendons ou les articulations. Le plus souvent les examens et l’imagerie ne donnent rien. « Vous n’avez rien, tout est normal ! » leur dit-on au final. Et pourtant les douleurs sont là…
« ÇA FAIT MAL, MAIS Y’A PAS DE MAL ! »
Un tissu endolori n’est pas forcément un tissu endommagé, de la même manière qu’une voiture en panne au bord de la route n’est pas forcément cabossée. Un problème « fonctionnel » n’est pas forcément associé à une atteinte structurelle… Pour comprendre ce qui se passe, attardons-nous un moment sur la façon dont notre organisme perçoit la douleur. Comme pour la vue, l’odorat ou le goût, il existe dans notre corps des zones réceptrices de la douleur.
 L’origine de la sensation douloureuse se situe en fait au niveau de structures cellulaires portant le nom de « récepteurs ». Ces récepteurs réagissent à des stimuli perçus comme nocifs ou nuisibles. Il peut s’agir de pression, de chaleur, de froid, ou de tension extrême. Ces récepteurs enregistrent ces changements et il s’ensuit une cascade d’événements dans ces cellules, avec en point d’orgue l’envoi d’un influx nerveux. Les influx sont transmis au cerveau par deux sortes de fibres distinctes, empruntant des voies différentes. On distingue en fait une douleur « lente » et une autre qualifiée de « rapide », aux caractéristiques dissemblables.
L’origine de la sensation douloureuse se situe en fait au niveau de structures cellulaires portant le nom de « récepteurs ». Ces récepteurs réagissent à des stimuli perçus comme nocifs ou nuisibles. Il peut s’agir de pression, de chaleur, de froid, ou de tension extrême. Ces récepteurs enregistrent ces changements et il s’ensuit une cascade d’événements dans ces cellules, avec en point d’orgue l’envoi d’un influx nerveux. Les influx sont transmis au cerveau par deux sortes de fibres distinctes, empruntant des voies différentes. On distingue en fait une douleur « lente » et une autre qualifiée de « rapide », aux caractéristiques dissemblables.
Un stimulus douloureux provoque d’abord une sensation vive, aigüe, comme dans le cas d’une rupture de tendon ou d’une déchirure au mollet. C’est la douleur « rapide ». Elle est également bien localisée : on peut décrire très précisément l’endroit où on a mal. Un grand nombre de blessures survenant en cours d’activité physique s’inscrivent dans ce cadre. La douleur instantanée correspond à une atteinte tissulaire.
Il lui succède une douleur sourde, pénible, diffuse et désagréable, de survenue plus tardive. Plus le stimulus est appliqué loin du cerveau, plus ces deux sensations sont séparées dans le temps. C’est ce qu’on observera par exemple en cas de blessure au pied. Douleur rapide ou retardée, tous ces messages aboutissent dans une aire du cerveau spécialisée dans le traitement de cette information.
Passés les premiers jours, le coureur atteint d’une déchirure ou d’une fracture ressent une douleur diffuse, moins intense, qu’il situe parfois moins précisément que lors de la survenue de l’accident. La douleur lente est également caractéristique des douleurs profondes, souvent organiques, difficiles à localiser, comme dans le cas des cancers ou lors de l’inflammation. Celle-ci représente la réponse adoptée par l’organisme face à une atteinte tissulaire, et sa finalité vise à favoriser la guérison, indispensable à la survie. Ses manifestations les plus évidentes sont le gonflement, la rougeur, la chaleur, la douleur et la perte de fonction des zones concernées. Initialement, cette douleur de l’inflammation correspond aux processus se tenant dans la cellule en cours de réparation ou d’élimination. Cette phase de « nettoyage » s’accompagne de la libération de multiples molécules, dont certaines peuvent générer une sensation douloureuse. Lorsque la réponse inflammatoire est physiologique, elle s’éteint progressivement, à mesure que la guérison survient. Mais, de plus en plus souvent, cette réponse s’emballe et se pérennise. Comme un feu de brindilles qu’on n’arrive pas à éteindre, l’inflammation déborde de son cadre initial et « flambe » un peu partout. C’est dans ce contexte, par exemple, qu’on peut voir des associations « tendinites- sinusite- otite », le suffixe « ite » signalant la présence d’une inflammation devenue chronique et invalidante.
Les causes de cette anomalie sont discutées plus loin. La douleur reste très présente, même plusieurs semaines ou plusieurs mois après l’atteinte d’origine. Le coureur se plaint, il a mal lorsqu’il accomplit certains gestes. L’imagerie ne montre rien de précis, et les soins prodigués restent souvent sans effet. On en reste au stade des spéculations, des interprétations (parfois fantaisistes), ou de la recherche d’anomalies anatomiques que, jusque là, on n’aurait pas vues. Comme chez ce coureur de trail, atteint d’une tendinite chronique à l’aube de sa dixième saison, et à qui on a déclaré que tous ses problèmes provenaient d’une jambe plus courte que l’autre. La question qui se pose est alors la suivante : pourquoi seulement au bout de dix ans ? Dans ce genre de situations, on n’a en fait pas d’explication cohérente, au point d’en venir, parfois, à invoquer une dimension « psy ».
En fait, dans ces situations, la douleur n’est alors plus la conséquence d’une atteinte tissulaire. C’est seulement le reflet d’une inflammation qui a perduré bien au-delà de l’agression à l’origine de cette réponse, comme chez ces footballeurs atteints de pubalgie, écartés des terrains pendant trois mois, et qui ont mal dès qu’ils retapent dans un ballon…
COMPRENDRE COMMENT CA MARCHE :
Les récepteurs à la douleur sont spécifiques. Ainsi, la douleur n’est pas déclenchée par une « surstimulation » des autres récepteurs (thermiques, cutanés, etc…).
 Par contre, ces « nocicepteurs » sont moins spécifiques que les autres, dans le sens où ils répondent à une grande variété de stimuli et que le déclenchement de la réponse nécessite un niveau de sollicitation supérieure à tous les autres stimuli sensoriels. Il a par exemple été calculé que leur seuil de réponse douloureux survient en réaction à une énergie thermique cent fois supérieure à celle qui fait qu’on perçoit le chaud. On ne se brûle pas à chaque fois qu’on touche de l’eau à 45°C, heureusement !
Par contre, ces « nocicepteurs » sont moins spécifiques que les autres, dans le sens où ils répondent à une grande variété de stimuli et que le déclenchement de la réponse nécessite un niveau de sollicitation supérieure à tous les autres stimuli sensoriels. Il a par exemple été calculé que leur seuil de réponse douloureux survient en réaction à une énergie thermique cent fois supérieure à celle qui fait qu’on perçoit le chaud. On ne se brûle pas à chaque fois qu’on touche de l’eau à 45°C, heureusement !
Il est admis qu’il existe des molécules spécifiques, qui sont libérées lors de la transmission de l’information douloureuse. On les appelle les « médiateurs chimiques » de la douleur. Lors des stimuli douloureux, ces agents chimiques, fabriqués dans nos tissus, sont libérés et vont agir sur les récepteurs, et donner naissance à la sensation douloureuse. Certains de ces agents appartiennent à la famille des « kinines », de toutes petites protéines comportant très peu d’acides aminés. Rappelons que les protéines sont de très grosses molécules. On peut les comparer à des mots de plusieurs milliers de lettres, écrits à partir d’un alphabet à vingt signes. Ces vingt motifs de base se nomment les « acides aminés ». Lors de la digestion, dans le tube digestif, les protéines doivent être scindées en molécules moins lourdes, puis en peptides (comportant de 8 à 20 acides aminés), lesquels sont à leur tour découpés en éléments encore plus simples. Au final, l’intestin assimile normalement les acides aminés libres. On verra qu’il n’en va pas toujours ainsi.
Par ailleurs, dans notre corps, certains tissus fabriquent des molécules, nommées « peptides », comportant quelques acides aminés, et dotés d’effets physiologiques particuliers. C’est ainsi le cas des ces « kinines », mais aussi des « endorphines », davantage connues des coureurs, ou de bien d’autres molécules. Ces kinines peuvent aussi être libérées lors d’une réaction inflammatoire, et participer à la douleur, parfois difficile à localiser, qui l’accompagne. Elles agissent alors en diffusant jusqu’aux récepteurs douloureux les plus proches.
L’INTESTIN PASSOIRE :
Pour comprendre cette énigme des douleurs sans lésion, il nous faut aborder un point crucial, l’intestin. Normalement, ce dernier constitue un organe étanche, développant une surface d’échange de 300 m², et d’une épaisseur de 30 microns. Il abrite un très grand nombre de bactéries (10 puissance 14) et 80% des cellules dites « immuno-compétentes » en sont originaires.
 Cet intestin est très demandeur en énergie et en sang, à la fois pour assurer l’apport de nutriments indispensables à son bon fonctionnement, et pour assurer l’exportation de déchets à éliminer. Au repos, aucun problème ne se pose chez un sujet sain. Par contre, à l’effort, il en va différemment. A ce moment-là, l’afflux de sang augmente très nettement au niveau des muscles actifs. On estime qu’il est multiplié par 20, certaines fibres pouvant toutefois accroître leur consommation d’oxygène 40 à 50 fois dans le contexte d’un effort maximal.
Cet intestin est très demandeur en énergie et en sang, à la fois pour assurer l’apport de nutriments indispensables à son bon fonctionnement, et pour assurer l’exportation de déchets à éliminer. Au repos, aucun problème ne se pose chez un sujet sain. Par contre, à l’effort, il en va différemment. A ce moment-là, l’afflux de sang augmente très nettement au niveau des muscles actifs. On estime qu’il est multiplié par 20, certaines fibres pouvant toutefois accroître leur consommation d’oxygène 40 à 50 fois dans le contexte d’un effort maximal.
Si par ailleurs l’effort est accompli dans la chaleur, il va falloir un afflux sanguin accru au niveau de la peau afin d’assurer une thermorégulation appropriée. Notons que dans des conditions de déshydratation, l’irrigation des intestins chute fortement, à moins de 10% de sa valeur basale de repos… cela va donner lieu à des atteintes tissulaires locales, pouvant s’accompagner de nécrose.
Lors du retour à une irrigation normale (qui peut demander de quelques mn à plusieurs heures selon les cas), la variation d’oxygénation est alors telle que les cellules intestinales doivent faire face à la production excessive de molécules « toxiques », formées dans des réactions parallèles, à partir de cet oxygène. On les nomme les « radicaux libres ».
Elle survient dans un tissu préalablement affecté par l’anoxie précédente et doté de défenses anti-radicalaires limitées. La répétition de ces épisodes va alors, de manière variable selon les cas, favoriser la pérennisation d’atteintes cellulaires entériques, dont les conséquences pourront être lourdes…
La diminution de l’irrigation intestinale peut indéniablement constituer une forme d’agression pour ce tissu. D’autres facteurs l’aggravent. A durée d’effort identique, le problème existe de manière beaucoup plus fréquente chez les coureurs, relativement aux cyclistes ou aux nageurs. Ceci est dû à l’existence d’une onde de choc transmise lors de chaque contact du pied sur le sol et qui, se transmettant aux viscères, finit par créer une agression mécanique. Citons aussi l’emploi des anti-inflammatoires. Ils sont prescrits pour combattre des inflammations chroniques, mais entretiennent une perméabilité intestinale excessive. De fait, leur emploi instaure un cercle vicieux dont il devient difficile de sortir. Enfin, l’insuffisance, dans les tissus, d’élément dotés d’effets anti-oxydants va contribuer à pérenniser les atteintes intestinales, notamment celles des structures moléculaires qui servent de joints étanches au niveau de la muqueuse, et qui se nomment les «jonctions serrées ». Cette présence insuffisante est souvent la conséquence de choix alimentaires inappropriés.
En raison de leur atteinte, la muqueuse devient alors anormalement perméable. Cette hyperperméabilité favorise le passage de divers types de molécules dans la circulation. Il s’agira notamment de protéines alimentaires « entières » ou altérées à potentiel antigénique, c’est-à-dire identifiées comme « ennemis » par les globules blancs intestinaux et circulants. Elles n’ont rien à faire là. Normalement, comme on l’a vu plus haut, elles sont complètement dégradées dans l’intestin, pour donner lieu à libération puis à l’absorption d’acides aminés. Cette arrivée d’antigènes va susciter une réponse de la part du système immunitaire. Fixés sur les tissus, ces protéines vont déclencher une réponse à caractère inflammatoire. Elle s’observera indifféremment dans les muscles, les tendons, les articulations… et durera tant que ces antigènes arriveront, sans atteinte tissulaire décelable !
Par ailleurs habituellement, lors de la digestion, ces chaînes protéiques sont scindées en d’autres chaînes plus courtes, comportant quelques acides aminés. On parle de « peptides ». Ils peuvent, dans ce contexte, diffuser dans la circulation, du fait que l’intestin est beaucoup moins étanche qu’à la normale. Leur présence ne suscite pas de réponse immunitaire (car les peptides présentent une taille insuffisante). Par contre, en raison de leur forte ressemblance avec d’autres peptide, issus quant à eux de notre organisme (comme les « kinines » évoquées tout à l’heure), ils vont se montrer capables d’agir à distance sur les récepteurs de divers organes (muscle, neurone, oreille interne…) et de provoquer des messages « parasites ». Parmi ces informations « parasites », on va noter, au niveau des « nocicepteurs », un état de stimulation comparable à celui qui existe, par exemple, en cas de véritable stimulus douloureux. Il s’agit en quelque sorte d’une douleur d’origine « virtuelle », comme dans le cas de la fibromyalgie, maladie à laquelle un mémoire récent, très intéressant, vient d’être consacré. L’athlète aura alors mal, surtout après une séance, et tous les examens couramment pratiqués ne sauront pas lui dire l’origine de son mal.
Ce schéma très fréquemment rencontré va survenir en présence de plusieurs erreurs simultanées, que nous allons maintenant passer en revue.
Denis Riché
Doctorat en nutrition humaine et
Spécialiste français de la micronutrition
SDPO-mag 16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt Tél : 01 39 94 01 87
Site Internet : www.sdpo.com Email : sdpo@sdpo.com